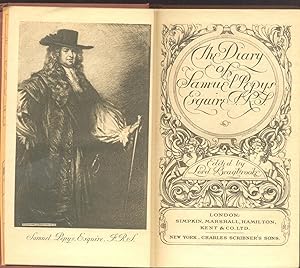television.telerama.fr
Au Sud de la Fente ( 2 fin )
- Eh ! qu'est-ce que ça peut vous faire ? rétorqua-t-il. Filez et sortez de mon chemin. Je veux pouvoir me retourner.
L'instant d'après, malgré son imposante carrure, quelqu'un le poussait à faire demi-tour et l'envoyer vaciller, la malle lui faisant perdre l'équilibre, jusqu'à ce qu'il tombât contre le mur derrière lui. Il se mit à jurer mais se rendit soudain compte qu'il avait devant lui Mary Condon, dont les yeux furieux lançaient des flammes.
- Bien sûr que j'appartiens au syndicat, dit-il. Je vous faisais marcher.
- Où est votre carte ? demanda-t-elle sur un ton péremptoire.
- Dans ma poche. Mais je peux pas la sortir maintenant. Cette foutue malle est trop lourde. Venez jusqu'à ma wagonnette et je vous la montrerai.
- Posez cette malle, ordonna-t-elle.
- Pourquoi donc ? J'ai une carte, je vous dis.
- Posez-la, c'est tout. Je ne vais pas laisser un jaune manipuler cette malle. Vous devriez avoir honte, espèce de lâche, vous qui trahissez des travailleurs honnêtes. Comportez-vous comme un homme et rejoignez le syndicat.
Le visage de Mary Condon était blême. Elle était, à l'évidence, en rage.
- Penser qu'un homme fort comme vous devient un traître à sa classe ! J'imagine que vous n'attendez que de vous joindre à la milice pour tirer sur des syndicalistes lors de la prochaine grève ! Peut-être même que vous appartenez déjà à la milice. Vous êtes bien du genre...
- Oh là, ça suffit !
Bill laissa tomber la malle par terre dans un grand fracas, se redressa et enfonça la main dans la poche intérieure de son manteau.
- Je vous ai dit que je vous faisais marcher. Tenez, regardez ça.
C'était une carte syndicale parfaitement en règle.
- D'accord, allez-y, dit Mary Condon. Et la prochaine fois ne plaisantez pas.
Son visage se détendit quand elle vit l'aisance avec laquelle il mit la lourde malle sur ses épaules et ses yeux brillèrent en observant l'élégante carrure de cet homme. Toutefois, Bill n'en vit rien, trop occupé à déplacer la malle. pressdemocrat.com
- Eh, vous ! Mr Totts, dit-elle. Aidez-moi, je veux entrer.
Bill sursauta, agréablement surpris. Elle se rappelait son nom pour l'avoir lu sur sa carte syndicale. L'instant d'après, le directeur avait été écarté de la porte et déblatérait sur le respect de la loi, tandis que les filles désertaient leurs machines. Pendant le reste de cette courte grève couronnée de succès, Bill agit en tant qu'homme de main et messager de Mary Condon. Puis, quand tout fut terminé, il retourna à l'université, redevint Freddie Drummond et se demanda ce que Bill Totts pouvait trouver à une telle femme.
Freddie n'avait pas été atteint, mais Bill était tombé amoureux. Il était inutile de le nier et c'était ce qui, pour Freddie Drummond, représentait le danger. Eh bien, il avait accompli son travail. Ses aventures pouvaient maintenant cesser. Il n'avait plus besoin de franchir la Fente. Il ne manquait que trois chapitres à son dernier ouvrage, Tactiques et Stratégies des syndicats, et disposait de suffisamment de données pour les écrire convenablement.
Il parvint également à la conclusion que s'il voulait affermir et ancrer son identité en tant que Freddie Drummond il lui fallait nouer des liens plus intimes au sein de son propre milieu social. Il était temps pour lui de se marier, et il se rendait bien compte que si Freddie ne le faisait pas, Bill ne manquerait pas de s'en charger, ce qui entraîneraient des complications épouvantables auxquelles il ne voulait même pas songer. C'est ainsi que Catheriene Van Vorst fit son entrée. Elle travaillait aussi à l'université, et son père, le seul qui disposât d'une fortune personnelle, dirigeait le département de philosophie. Lorsque les fiançailles furent annoncées officiellement, Freddie pensa que c'était en tous points un mariage avisé. D'apparence froide et réservée, Catherine était aristocrate et sainement conservatrice. Bien qu'elle fût chaleureuse à sa manière, elle possédait une forme de retenue égale à celle de Freddie.
Tout semblait réussir à Freddie Drummond, mais il ne pouvait se défaire totalement des bas-fonds, de l'attrait de la liberté et de la vie sans entraves ni responsabilités qu'il avait menée au sud de la Fente. Alors que le jour de son mariage approchait, il s'aperçut qu'il avait bel et bien pris du bon temps et de plus et, de plus, qu'il lui serait extrêmement agréable d'effectuer une nouvelle escapade, de jouer au bon vivant et au panier percé une dernière fois, avant de retourner définitivement à ses amphithéâtres sévères et à son austère future épouse. Comme pour le tenter le tout dernier chapitre de Tactiques et Stratégies des Syndicats demeurait à écrire faute de quelques données essentielles qu'il avait négligé de collecter.
De retour dans son bureau il n'aimait pas penser à cet épisode. Ce souvenir ne rendait que plus oppressant le sentiment de danger qu'il avait éprouvé. Bill Totts s'était comporté de manière abominable. Non seulement il avait rencontré Mary Condon au conseil central du travail, mais il s'était arrêté avec elle dans un restaurant sur le chemin du retour et lui avait offert des huîtres. Pis encore, avant de la quitter devant sa porte, il l'avait prise dans ses bras et l'avait embrassée sur les lèvres à plusieurs reprises. Les derniers mots de Mary restaient dans son oreille, des mots prononcés doucement, avec un touchant sanglot dans la gorge qui n'était autre qu'un cri d'amour :
- O Bill, mon cher Bill, mon très cher Bill.
Freddie Drummond frissonnait à ce souvenir, il voyait s'ouvrir un gouffre sous ses pieds. N'étant pas, par nature, polygame, il était épouvanté par les possibilités qu'offrait la situation.
Celle-ci allait devoir prendre fin et pour cela il ne voyait que deux possibilités : soit devenir entièrement Bill Totts et épouser Mary Condon, soit rester entièrement Freddie Drummond et épouser Catherine Van Vost, faute de quoi son comportement deviendrait pire que méprisable, abject.
Au cours des mois qui suivirent San Francisco fut déchiré par des conflits sociaux. Les syndicats et les associations du patronat s'étaient engagés dans le combat avec une détermination qui donnait à penser qu'ils comptaient régler leur différend dans un sens ou dans l'autre, une fois pour toutes. Cependant Freddie corrigeait les épreuves de son livre et donnait des cours, et ne bougea pas d'un pouce. Il se consacrait à Catherine Van Vost et, jour après jour, trouvait plus de raison de l'admirer et de la respecter, voire de l'aimer. La grève des conducteurs de tramway le tenta, mais pas aussi fortement qu'il ne l'aurait imaginé, et la grande grève des bouchers le laissa froid. Le fantôme de Bill Totts avait été éliminé et Freddie Drummond s'attaqua avec une ardeur renouvelée à la rédaction d'un opuscule qu'il projetait d'écrire depuis longtemps sur les rendements décroissants.
Il n'était qu'à deux semaines de son mariage quand, un après-midi, Catherine Van Vorst vint le chercher et l'arracha à ses occupations pour l'emmener voir une maison des enfants récemment créée dans le cadre de l'oeuvre de bienfaisance à laquelle elle participait. La voiture appartenait à son frère, mais ils étaient seuls avec le chauffeur. Au point où elles croisent Kearny Street, Market Street et Geary Street se rejoignent comme les branches d'un V à angle aigu. Dans leur automobile, Frederick et Catherine descendaient Market Street et s'approchaient du virage en tête d'épingle pour prendre Geary Street. Néanmoins ils ignoraient ce qui arrivait par Geary Street à ce moment-là, programmé par le destin pour les rencontrer dans le virage. Bien qu'il fût informé par les journaux que la grève des bouchers faisait rage, Freddie Drummond n'y pensait pas le moins du monde. N'était-il pas assis à côté de Catherine ? En route il était occupé à lui exposer son point de vue sur l'activité des oeuvres de bienfaisance, point de vue que les aventures de Bill Totts avaient contribué à nourrir.
Par Geary Street arrivaient six chariots à viande. A côté de chaque jaune qui conduisait était assis un policier. A l'avant, à l'arrière et de part et d'autre de cette procession défilait une escorte d'une centaine d'agents. Suivant l'arrière-garde policière, à une distance respectueuse, une foule avançait tranquillement mais vociférant des slogans, occupant la rue sur toute la longueur et sur une longueur de plusieurs pâtés de maisons. Le consortium des bouchers tentait de fournir de la viande aux hôteliers et, incidemment, de commencer à briser la grève. L'hôtel St Francis avait déjà été livré, au pris de maintes fenêtres brisquées et de nombreux coups sur la tête, et l'expédition avançait à présent pour apporter des vivres au Palace Hôtel. shc.stanford.edu
A cet instant Freddie Drummond interrompit la conversation. Il ne la reprit pas car la situation évoluait avec la rapidité d'un changement à vure au théâtre. Il entendit le rugissement de la foule à l'arrière et aperçut les policiers casqués et les chariots à viande qui vacillaient. Au même instant, reprenant son rôle et donnant du fouet le conducteur du chariot à charbon fit avancer ses chevaux et son véhicule jusque devant le défilé, puis tira brusquement sur les rênes et mit le frein, puis attacha fermement ses cordes sur le levier du frein et s'assit, visiblement décidé à ne plus bouger. L'automobile s'était arrêtée, elle aussi, Les gros chevaux haletants lui étant rentrés dedans.
Avant que le chauffeur ne pût se dégager, une wagonnette brûlante, conduite par un vieil Irlandais qui fouettait son unique cheval pour le mettre au galop, s'était coincée dans les rue de l'automobile. Drummond reconnut l'animal et la wagonnette, car il les avait fréquemment conduits lui-même. L'Irlandais n'était autre que Pat Morrissey. De l'autre côté, une carriole transportant des tonneaux de bière rentrait dans le chariot à charbon tandis qu'un tramway qui descendait Kearny Street en actionnant furieusement sa cloche se précipitait en avant pour parachever le blocus, le conducteur lançant des insultes à l'agent de la circulation. Un véhicule après l'autre venait s'enferrer au même endroit et ajouter à la confusion. Les chariots à viande s'arrêtèrent. Les policiers étaient piégés. Le rugissement à l'arrière augmenta alors que la foule rejoignait l'attaque, tandis que les policiers de l'avant-garde fonçaient sur les véhicules qui bloquaient le passage.
- Nous sommes cuits, remarqua Drummond calmement à l'adresse de Catherine.
- Oui, dit-elle avec un calme égal. Quels sauvages sont ces gens-là !
L'admiration qu'il éprouvait pour elle redoubla. Elle était bel et bien faite pour lui. Il n'aurait pas été choqué si elle avait poussé des hurlements et s'était accrochée à lui, mais une telle réaction...
C'était magnifique. Elle se tenait au milieu de cet ouragan avec la même sérénité que s'il s'était agi d'un embouteillage de calèches devant l'opéra. berkeleyheritage.com
Un agent de police, sous les ordres de son capitaine, escalada le chariot à charbon pour arrêter son conducteur. Celui-ci, se levant lentement et tranquillement comme pour lui obéir, saisit soudain l'agent dans ses bras et se jeta sur l'officier qui attendait en bas. Le conducteur était un jeune géant et, quand il monta au sommet de sa cargaison pour attraper un morceau de charbon de ses deux mains, un policier qui escaladait le chariot sur le côté lâcha prise et se laissa tomber au sol. Le capitaine ordonna à une demi-douzaine de ses hommes de prendre d'assaut le chariot. Le conducteur, passant d'un côté à l'autre de sa cargaison, les repoussait en leur lançant d'énormes morceaux de charbon sur la tête La foule sur les trottoirs et les conducteurs des chariots bloqués rugissaient de contentement. Le conducteur du tramway fracassait des casques de policiers avec sa manette de direction, mais les agents finirent par l'assommer et le tirer de sa plate-forme. Le capitaine, furieux que ses hommes eussent été repoussés, conduisit l'assaut suivant sur le chariot à charbon. Une vingtaine d'agents commencèrent à grimper de tous les côtés de cette forteresse, mais le conducteur semblait se démultiplier. Parfois, six ou huit policiers tombaient simultanément sur le pavé et roulaient sous le chariot. Occupé à repousser une attaque à l'arrière de sa forteresse, le conducteur se retourna et vit que le capitaine s'apprêtait à monter sur le siège à l'avant du véhicule. L'officier était encore en l'air et en équilibre instable quand le conducteur lança sur lui un morceau de charbon de trente livres. Le capitaine le reçut en pleine poitrine et tomba en arrière, rebondissant sur le dos d'un charron pour atterrir sur le sol, heurtant au passage la roue arrière de l'automobile.
Catherine crut qu'il était mort, mais il se releva et repartit à l'assaut. Elle tendit sa main gantée et flatta le flanc du cheval qui s'ébrouait en frissonnant. Cependant Drummond ne vit pas son geste. Il n'avait d'yeux que pour la bataille sur le chariot à charbon, tandis que, quelque part dans les méandres de sa psyché, un certain Bill Totts s'agitait et tentait de revenir à la vie. Drummond croyait au respect de la loi et au maintien des forces établies, mais le sauvage déchaîné qui était en lui ne voulait rien entendre. S'il y eut un moment où Freddie fit appel à sa volonté de fer pour se sauver, c'est bien celui-là. Mais il est écrit qu'une maison divisée ne peut que s'effondrer. Freddie Drummond découvrit que la moitié de sa volonté et de ses forces avaient été prises par Bill Totts et, au milieu, l'entité qui les constituait tous les deux se trouvait déchirée.
Freddie Drummond était assis dans l'auto, tout à fait calme à côté de Catherine Van Vorst, mais celui qui regardait par les yeux de Freddie Drummond c'était Bill Totts et, quelque part derrière ces yeux, se battant pour le contrôle de leur corps commun, se trouvaient Freddie Drummond, le sociologue conservateur et raisonnable, et Bill Totts, le syndicaliste belliqueux. Ce fut Bill Totts qui, par ces yeux, pressentit ce que serait le dénouement inévitable du conflit sur le chariot. Il vit un policier parvenir au sommet de la cargaison, puis un deuxième et un troisième. Les agents chancelaient sur cette surface irrégulière mais ils faisaient tournoyer leurs longues matraques dans les airs. Le conducteur reçut un coup sur la tête. Il en esquiva un second qui atterrit sur son épaule. A l'évidence la partie était finie pour lui. Il bondit en avant, attrapa deux policiers dans ses bras et se jeta sur le trottoir pour se constituer prisonnier, sans relâcher son emprise sur ses deux adversaires.
s'ensuivit. L'homme assis à côté d'elle poussa un hurlement d'une bestialité inouïe et se leva. Elle le vit bondir par-dessus le siège avant, sauter sur le large postérieur du charron et, de là, parvenir sur le chariot. Son assaut fut pareil à une tornade. L'agent de police stupéfait qui se tenait au sommet de la cargaison n'eut pas le temps de deviner l'intention de ce jeune homme bien habillé mais manifestement excité avant de recevoir un coup qui l'envoya valser dans les airs et retomber sur la chaussée. Un policier escaladant la cargaison reçut un coup de pied dans la figure qui lui assura le même sort. Trois autres agents montèrent au sommet et se précipitèrent sur Bill Totts qui, non content de recevoir un coup de matraque qui lui ouvrit le cuir chevelu, se vit arracher sa veste, son gilet et la moitié de sa chemise amidonnée. Il envoya, néanmoins, les trois policiers voler au loin et, faisant pleuvoir les morceaux de charbon sur ses opposants, il tint la forteresse.
Le capitaine prit courageusement les devants de l'attaque mais fut renversé par un morceau de charbon qui lui éclata sur le front, comme pour le baptiser de noir. L'objectif de la police était de dégager le blocus avant que la foule n'arrivât depuis l'arrière. Celui de Bill Totts, au contraire, de tenir le chariot jusqu'à ce même moment. C'est ainsi que la bataille du charbon se poursuivait.
La foule avait reconnu son champion. Big Bill, comme d'habitude, était en première ligne, et Catherine Van Vorst fut abasourdie d'entendre la foule cirer " Bill, ô Bill ! " de toute part. Pat Morrissey sur le siège de son chariot sautait en l'air et braillait d'une voix ravie :
- Vas-y Bill ! Paie-les toi ! Tu vas en faire qu'une bouchée !
Elle entendit une voix de femme hurler depuis le trottoir :
- Attention, Bill, droit devant !
Bill reçut l'avertissement et, de quelques coups de charbon bien placés, dégagea l'avant du chariot de ses assaillants. Catherine Van Vorst tourna la tête et vit, sur le bord du trottoir, une femme au teint coloré et aux yeux d'un noir profond dévorant du regard l'homme qui, quelques minutes auparavant, était encore Freddie Drummond.
Des fenêtres de l'immeuble surgit un tonnerre d'applaudissements. Un nouveau déluge de chaises de bureau et de classeurs à tiroirs vola dans les airs. La foule avait percé sur un côté le barrage des chariots et elle avançait, chaque policier isolé devenant le centre d'un combat. Les conducteurs jaunes furent arrachés à leurs sièges, les harnais des chevaux furent coupés et les bêtes terrifiées autorisées à s'enfuir. De nombreux policiers se glissèrent en rampant sous le chariot de charbon pour se protéger, tandis que les chevaux détachés, parfois accompagnés d'un policier qui les montait ou essayait de les retenir, s'élançaient sur le trottoir opposé et s'engouffraient dans Market Street. getyourwordsworth.com
- Décampe, Bill ! C'est maintenant ou jamais ! Fais vite !
La police avait momentanément disparu. Bill Totts sauta sur la chaussae et s'approcha de la femme sur le trottoir. Catherine Van Vorst la vit jeter les bras autour de son cou et l'embrasser sur la bouche. Elle continua à observer l'homme d'un oeil curieux, alors qu'il poursuivait son chemin sur le trottoir, un bras autour des épaules de cette femme, parlant et riant avec elle, avec un abandon et une volubilité qu'elle n'aurait jamais imaginés possibles.
La police était de retour pour relancer la circulation en attendant des renforts de nouveaux conducteurs et des che. Il avait toujours le bras autour des épaules de la femme. Assise dans son automobile, elle vit le couple traverser Market Street, franchir la Fente, puis disparaître dans Third Street pour rejoindre le quartier ouvrier.
Dans les années qui suivirent, plus aucun cours ne fut donné à l'université de Californie par le dénommé Freddie Drummond, et plus aucun livre d'économie sur le syndicalisme ne parut sous le nom de Frederick. En revanche, on nota l'apparition d'un nouveau meneur dans le mouvement ouvrier, du nom de William Totts. C'est lui qui épousa Mary Condon, présidente de la section n° 974 de la Fédération internationale des gantiers. C'est lui, de même, qui appela à la tristement célèbre grève des cuisiniers et garçons de restaurant qui, avant son succès final, fut ralliée par des dizaines d'autres syndicats au nombre desquels figuraient, pour ne citer que les plus éloignés, ceux des plumeurs de poulets et des entrepreneurs de pompes funèbres.
* pressdemocrat.com
** dailymail.co.uk
Jack London
( in Saturday Evenig Post le 22 mai 1909 )






 Si le comédien s'appuie, pour incarner son personnage, sur la logique conventionnelle et consentie, s'il le ramène dans la vie en tentant de copier très exactement tel et tel tics, maintes façons d'être du caractère qu'il croit propre à la fiction qu'il se propose d'animer, le voilà dès l'abord terriblement limité. Et insuffisant. Seule la transcendance peut donner vie à un héros digne de ce nom. Les bons comédiens - Fresnay - sont d'excellents psychologues à l'état primaire. Les grands acteurs devinent, opèrent par intuition. Osent.
Si le comédien s'appuie, pour incarner son personnage, sur la logique conventionnelle et consentie, s'il le ramène dans la vie en tentant de copier très exactement tel et tel tics, maintes façons d'être du caractère qu'il croit propre à la fiction qu'il se propose d'animer, le voilà dès l'abord terriblement limité. Et insuffisant. Seule la transcendance peut donner vie à un héros digne de ce nom. Les bons comédiens - Fresnay - sont d'excellents psychologues à l'état primaire. Les grands acteurs devinent, opèrent par intuition. Osent.